Au cœur des bienfaits de l’élevage familial pour faire face aux crises

L’élevage, un élément clé de la sécurisation alimentaire et filet de protection En temps de crise, l’élevage est facteur de résilience pour les populations en contribuant de différentes façons à leur subsistance quotidienne. L’élevage est tout d’abord un élément de sécurisation alimentaire par ses apports nutritifs en protéines animales (viande, lait, œufs) qui permettent tout au long de l’année de diversifier l’alimentation des ménages paysans. Par exemple, les produits laitiers sont une source de calcium indispensable au développement des plus jeunes et complètent des régimes basés essentiellement sur des céréales. Lors des périodes de soudure, où les réserves alimentaires s’épuisent et les nouvelles récoltes sont à venir, la vente d’animaux et de produits animaux apporte des ressources monétaires utilisées pour l’achat de nourriture. L’élevage est aussi une épargne à court et moyen terme, mobilisable rapidement pour des dépenses courantes (frais de scolarité, achat d’aliments) ou imprévues (maladies, accidents) et souvent vue comme plus sûre qu’un compte bancaire. La pandémie de Covid-19 a montré que l’élevage est une béquille pour de nombreux ménages ruraux accompagnés. Ceux-ci ont pu vendre une partie de leurs animaux pour pallier la fermeture des marchés et le ralentissement des échanges économiques sur leurs territoires. Par ces différentes contributions, l’élevage permet aux paysans d’atténuer et de prévenir les risques alimentaires et économiques. Pendant le confinement sanitaire, les éleveuses ont aidé des familles à se nourrir avec leur lait de chèvre. L’élevage, un levier d’insertion socio-économique des publics marginalisés Pour les catégories de populations les plus défavorisées comme les femmes, les jeunes, migrants et réfugiés, les périodes de crises structurelles ou conjoncturelles renforcent les inégalités sociales existantes. Ces populations ont très peu accès à des ressources pour produire, que ce soit des animaux, des terres, etc. Quand elles y ont accès, la question de la propriété et du contrôle des cheptels et des parcelles est primordiale pour pérenniser l’activité économique et faire que ses retombées bénéficient bien à celles et ceux qui travaillent. ESF intègre de manière transversale cette problématique dans son action en ciblant ces publics fragiles comme prioritaires et en adaptant les actions à leurs problèmes spécifiques. Les projets s’appuient sur le principe du « microcrédit en animaux », qui permet la responsabilisation des éleveuses et éleveurs sans les confronter à des microcrédits monétaires. Le risque du surendettement est ainsi évité pour les populations les plus fragiles. Pour les populations précarisées, les petits élevages mis en place sont des facteurs d’intégration sociale grâce aux fonctions sociales et culturelles que remplit l’élevage (dons d’animaux pour les fêtes culturelles et religieuses notamment). Une fois l’activité constituée et maitrisée, cela représente pour ces individus isolés une source d’aliments non négligeable et de nouveaux revenus leur permettant de sortir de la situation de pauvreté dans laquelle ils se trouvaient. Les petits élevages sont un moyen d’enrayer la spirale de la pauvreté. L’élevage tend à réduire les risques face aux aléas climatiques Les paysans les plus vulnérables dans les pays en développement où agit l’association paient le lourd tribut du dérèglement climatique. Les variabilités climatiques, telles que les irrégularités de la pluviométrie, les sécheresses prolongées et les inondations fragilisent leurs moyens d’existence. Pour les agroéleveurs accompagnés, les stratégies d’adaptation développées permettent une diversification des productions végétales et animales pour répartir les risques et gagner en autonomie financière. L’intégration culture-élevage contribue à construire une transition vers des systèmes agricoles et des pratiques agroécologiques durables. L’utilisation du fumier composté dans la fertilisation des sols de culture ou pâturage permet le stockage du carbone et un gain de rendements des cultures vivrières et de vente. L’accompagnement technique d’ESF permet de vulgariser des pratiques innovantes pour s’adapter à ces nouvelles conditions et sécuriser les activités de petit élevage : le stockage de fourrage et l’introduction de culture fourragère pour l’alimentation animale. Enfin, en soutenant l’organisation des filières sur les territoires, ESF contribue à plus de valorisation des produits animaux et au développement de filières courtes, moins carbonées et plus rémunératrices pour les éleveuses et éleveurs. Les élevages familiaux contribuent au maintien de la fertilité des sols, à la biodiversité et à l’amélioration des cultures. Utilisation des déjections des animaux pour une meilleur fertilité des sols.
Témoignage de Moïse Albert, Gérant de la micro-laiterie ‘Let’Agogo’ – Haïti

Je suis Moïse ALBERT, de nationalité Haïtienne, célibataire, domicilié à Belladère. Je suis diplômé en informatique bureautique et comptabilité en République dominicaine, puis j’ai obtenu une licence en Sciences Comptables (promotion 2011-2015). J’ai travaillé en tant qu’Officier à Micro Crédit National SA en 2013, puis comme Agent de suivi au programme National de cantines scolaires de 2014 à 2018. Actuellement, je travaille comme Responsable de la laiterie de Belladère. Je suis aussi le Coordonnateur de l’Organisation des Jeunes Progressiste pour le Développement de Regadère. La laiterie de Belladère se situe à Mireau, première section Renthe Mathé. Elle est l’unique micro-entreprise de transformation dans l’arrondissement et de la commune. Le peu de financements et d’autres difficultés structurelles freinent la micro-laiterie dans son bon fonctionnement. Actuellement, elle produit uniquement du lait stérilisé car nous ne disposons pas de chaine de froid pour la production de yaourt et de fromage. Même pour la fabrication du lait stérilisé, nous faisons face à des problèmes d’approvisionnement. En effet, le lieu où se trouve la micro-laiterie est éloigné de certaines zones de production de lait. Les producteurs laitiers manquent encore d’organisation dans la vente collective de leur lait, ce qui entraine un coût de production de lait stérilisé très élevé car la collecte du lait est insuffisamment organisée. Le projet « Lait des Collines de Lascahobas » prévoit de nous apporter des appuis techniques et financiers pour viabiliser l’activité économique de laiterie. Au démarrage du projet, la laiterie était fermée en raison d’une insuffisance de lait en période sèche. Avec l’appui du projet, la laiterie a repris ponctuellement son activité de transformation et les problèmes liées à l’insuffisance d’intrants et d’équipements sont en partie résolus avec les dotations en contenants, capsules, l’achat d’intrants pour la production du lait stérilisé et la matière première. Actuellement, nous avons identifié huit grandes zones de collecte sur toute la commune. Toutefois, pour mettre ces éleveurs en confiance afin qu’ils fassent la traite régulière de leurs animaux pour alimenter la laiterie en lait, nous sommes en train de les soutenir pour monter une organisation d’éleveurs producteurs de lait dans la commune. Le Coach en entreprise qui suit la laiterie, nous appui dans l’organisation des éleveurs dans la collecte du lait. Pour la collecte, nous passons dans les zones de production tous les matins avec une moto tricycle et les éleveurs apportent le lait au collecteur. Ce dernier effectue des tests de qualité comme : le test de densité, d’alcool, d’iode et un test sensoriel avant de prendre le lait et de payer le producteur soit sur place ou chaque semaine. Arrivé à la laiterie, le lait subit encore des tests de qualité, puis un filtrage avant la pasteurisation (90°C). Après la pasteurisation on laisse la température du lait diminuer jusqu’à 75°C pour passer au remplissage des bouteilles, suivi du capsulage des bouteilles stérilisées. Généralement, on laisse le lait en observation pendant cinq (5) à huit (8) jours avant de les commercialiser. Aucune bouteille de lait stérilisé n’est autorisée à quitter la laiterie sans étiquette. Cette dernière, qui joue un rôle important dans la chaine d’approvisionnement du lait, constitue un outil essentiel pour transmettre au consommateur des informations sur le produit. L’existence de la laiterie est porteuse de débouchés économiques pour les éleveurs dans la mesure où ces derniers font tous les jours la traite des vaches et continuent de vendre leur lait à la laiterie. Normalement, un éleveur qui possède seulement une vache qui peut donner un gallon de lait par jour pourrait générer en moyenne 2 euros. Actuellement, on a une dizaine de boutiques qui achètent le lait et le revendent. De plus, avec une plus grande production de lait, la laiterie augmentera son staff. Ainsi, il y a des débouchés pour les éleveurs, pour les boutiques/commerçants et pour les jeunes de la commune. Le lait des collines de Lascahobas Améliorer les conditions de vie de la jeunesse rurale haïtienne par le développement d’une filière lait local JE DÉCOUVRE Projet
La cuniculture, un tremplin pour les jeunes filles en situation de vulnérabilité

Un nouveau projet innovant au Bénin Le 23 Juin 2021 s’est tenu dans les locaux de la maire de la commune de ZA-KPOTA dans le département du Zou au Bénin, le lancement d’un projet innovant des sociétés civiles et coalition d’acteurs intitulé : La cuniculture, un tremplin de réussite pour les jeunes filles en situation de vulnérabilité dans la commune de ZA-KPOTA. C’est un projet qui vise, à travers l’élevage et la commercialisation du lapin, l’insertion socio-professionnelle de 30 jeunes filles qui sont pour la plupart des filles mères âgées de 15 à 22 ans sans aucun soutien de leurs familles. Ce projet est financé par Elevages sans frontières et l’ambassade de France au Bénin et est réalisé par Eleveurs Sans Frontières Bénin (ESFB), notre partenaire au Bénin. https://elevagessansfrontieres.org/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Video-2021-06-28-at-14.21.24.mp4
Silence, ça tourne à Ouarzazate

Film de capitalisation sur la projet « Or blanc du Haut-Atlas » Nous avons récemment réalisé un guide de capitalisation sur notre action au Maroc, car après 15 ans d’action, il était de temps de mettre tout ça par écrit. Cela a permis de produire un guide papier ou numérique, qui explique notre intervention, à Elevages sans frontières et ROSA, pourquoi et comment on a appuyé des femmes en zone rurale autour de Ouarzazate, dans le cadre du projet « Or blanc du Haut Atlas ». Il manquait à ce guide un écho plus subjectif et qualitatif du « terrain », comme on dit. Prendre le temps de filmer d’écouter les femmes qui sont appuyées et accompagnées, prendre le temps également d’écouter et filmer l’équipe de ROSA, notre partenaire local. Un film est donc en cours de tournage, avec l’objectif et l’ambition de compléter le guide, plus technique. Ce film a comme objectif non pas de décliner le guide en image, mais bien de le compléter, de montrer les impacts du projet sur la vie et la trajectoire des femmes éleveuses. On revient vers vous bientôt avec le résultat en images ! Date du tournage : du 19 au 30 juin Lieu : Ouarzazate, Tammasint, Tifoultoute Découvrez le guide de capitalisation sur notre action au Maroc Consultez
L’entrepreneuriat, une voie vers l’autonomie au Togo

Concours pour appuyer l’entrepreneuriat au Togo Elevages sans frontières en partenariat avec les acteurs du projet « Or gris des savanes », ont organisé un concours. Ce concours consistait, pour les artisans et élèves intéressés, à élaborer un plan d’affaires en lien avec l’amélioration des équipements des aviculteurs (mangeoires, abreuvoirs, couveuses etc.). Les 10 meilleurs plans d’affaires ont été sélectionnés par un jury. Chacun d’entre eux a remporté 250 000 FCFA (382€) pour lui permettre de mettre en œuvre son plan d’affaire. L’une d’elle, KANGNAGUIBE LENGUE, nous livre son témoignage : Je suis âgée de 60 ans, mariée et mère de 6 enfants. J’ai commencé à exercer la poterie, il y a plus de 30 ans. Je l’ai appris de ma belle-mère suite aux difficultés financières que j’avais pour me permettre à subvenir aux besoins de ma famille et à sauver mon couple à l’époque. Cette activité est devenue mon activité principale et je l’exerce avec beaucoup de dévouement. Je suis responsable d’un regroupement de 7 femmes potières à Sibortoti, à 5 km de Dapaong. Créé il y a 3 ans, ce groupement, réuni au tour de la poterie, cotisait jusqu’alors 600 FCFA par mois. Cette somme était remise à tour de rôle à chacune comme fonds de roulement. J’ai bénéficié comme toutes les autres du projet « OR GRIS DES SAVANES », qui nous a appuyé en bâtiment, en équipements et en fonds de roulement soit une subvention de 250 000FCFA pour booster notre activité. Aujourd’hui, je me sens plus à l’aise dans l’exercice de mon activité puisque j’ai à ma disposition le matériel nécessaire (bâtiment, bassines, pelle, pioche) et un fonds de roulement. Cet appui a permis une augmentation de mon offre, de mon chiffre d’affaire et donc des bénéfices. Ainsi, le montant de notre cotisation est passé de 600 à 3000F/ mois par membre. Je fabrique des pots de chauffes, des abreuvoirs, des canaris, des jarres, des pondoirs, des ruches en pot, tout dépend de la demande ou de la commande faite. Je dis un sincère merci à ESFT qui nous a aidées à devenir plus professionnel, à travailler plus et à être plus reconnus dans le milieu. Nous œuvrons à devenir une référence à Dapaong. Le processus de fabrication de pots est simple, il suffit de s’y connaitre et d’y mettre la volonté. Après l’achat de l’argile, elle est renversée dans une jarre, un tonneau ou dans un récipient plus grand. On y ajoute de l’eau pour qu’elle soit bien humectée. L’argile humectée est sortie, malaxée, pilée jusqu’à ce qu’elle soit homogène et adhésive. Elle est ensuite mise en tas et recouverte de plastic pour éviter qu’elle se dessèche. Maintenant que la matière première est prête à la fabrication de la poterie, de petits morceaux sont prélevés et modelés à la main pour construire et donner la forme désirée. Les différents articles fabriqués sont ensuite polis et cuits au four traditionnel après s’être desséchés. J’ai beaucoup apprécié l’appui du projet « Or gris des Savanes » car elle m’a permis de signer le contrat à ma fille pour son apprentissage. Avec 40 000 FCFA injecté dans la poterie en février, j’ai réalisé pour un mois d’activité un bénéfice de 45 000 FCFA dont 35000 FCFA a servi à l’achat de vélo. Vraiment, merci à ESFT. La majeure difficulté rencontrée dans mon activité est le transport de la matière première et des articles pour le marché qui revient cher. Ne disposant pas de moyens de transport propres à nous, il nous arrive d’arriver au marché quelque fois dans l’après-midi ce qui souvent joue sur le chiffre d’affaire à réaliser. Avec le temps, nous comptons nous acheter un tricycle pour faciliter le transport de nos articles avec l’appui de ESFT. Encore merci à nos donateurs. Pour en savoir davantage sur le projet Or gris des Savanes Cliquez ici
Partage et débat autour d’innovations du projet « OR GRIS DES SAVANES »

Partage et débat autour d’innovations du projet « OR GRIS DES SAVANES » Les 9 et 10 juin 2021, à Dapaong, ESF et ses partenaires ont tenu un atelier multi-acteurs pour diffuser les résultats d’études menées avec les acteurs de la chaine de valeur pintade dans le cadre du projet « OR GRIS DES SAVANES ».Ces études ont porté sur : la facilitation de l’accès à l’investissement pour les éleveurs la comparaison de matériels d’incubation l’amélioration des aliments pour pintades le développement d’alliances productives autour d’une provenderie et d’une unité de transformation de la pintade. Un beau passage en revue des expérimentations menées en milieu paysan dans les Savanes du Nord Togo qui illustre la philosophie de Recherche-Action dans laquelle s’inscrit le projet. De riches contributions qui aident à préparer les suites de cette 1ère phase de projet et qui précisent la voie dans laquelle s’inscrit le modèle de production et de valorisation des pintades « OR GRIS DES SAVANES ». Merci aux consultants, stagiaires, partenaires et autres acteurs locaux qui se sont investis sur ces travaux. https://elevagessansfrontieres.org/wp-content/uploads/2021/06/video-1623677700.mp4 Vivement le prochain atelier pour une présentation-débat d’autres innovations développées ! 👍 Pour en savoir davantage sur le projet Or gris des Savanes Cliquez ici
Après 6 mois du projet au Maroc Imik S’Imik, où en sommes-nous ?

Elevages sans frontières et Rosa appuient l’activité d’élevage au Maroc comme levier d’autonomie pour les femmes depuis 2005. Le lancement en janvier 2021 du projet Imik s’Imik « petit à petit », avec le soutien de l’Organisation Internationale de la Francophonie, est une nouvelle étape dans l’accompagnement des jeunes femmes de la région de Ouarzazate. Après 6 mois d’activité, quelques éléments de bilan et de satisfactions sont déjà là. Avec Imik S’ Imik, ESF & ROSA pensent à la relève ! En janvier 2021, la crise sanitaire a fragilisé l’économie locale et la confiance des femmes rurales en l’avenir. Cet avenir réside dans la jeunesse et la transmission des savoirs ! C’est dans ce contexte qu’est lancé le projet « Imik S’Imik », dont les objectifs sont d’inciter les jeunes femmes à développer une activité d’élevage, à en faire une activité rémunératrice grâce à des formations et un accompagnement de proximité. Le projet vise également à favoriser les échanges entre femmes, renforcer leurs liens sociaux et faire de leurs dynamiques collectives des leviers d’émancipation et de partage de savoirs. Lors du lancement du projet en janvier, l’hypothèse que le métier d’éleveuse n’attire plus les jeunes générations s’est confirmée : peu de jeunes femmes étaient présentes lors des sessions d’information sur le projet. De plus, les aînées sous-estiment souvent les capacités d’apprentissage des plus jeunes : les membres des associations féminines étaient peu favorables à cette orientation du projet en faveur des jeunes. Après des temps d’échanges avec les aînées et les jeunes, quelques jeunes femmes se sont laissé convaincre pour apporter un vent de fraîcheur et un regard neuf sur l’activité. Leur réussite et leur plaisir de s’impliquer dans le projet, tant sur le plan personnel que professionnel, suscite déjà l’engouement et l’adhésion d’autres jeunes femmes qui ont exprimé leur souhait de rejoindre les associations locales pour pouvoir un jour compter parmi les nouvelles jeunes éleveuses entrepreneures. Après 6 mois de projet, ce sont donc 25 femmes dont 16 qui ont mois de 35 ans, qui ont démarré un élevage de chèvres laitières. Un parcours de formations enrichissant ! En mars et avril 2021, les 25 bénéficiaires du projet ont pu suivre le premier parcours de formations en gestion et entreprenariat en langue locale, organisé en partenariat avec le bureau d’étude IGHIL DARAA. Cette formation a été faite en parallèle des formations en technique d’élevage que réalise ROSA. En effet, pour convaincre les jeunes de se lancer dans l’activité d’élevage, la dimension économique est particulièrement importante. Ce nouveau cycle de formations fut une très belle réalisation qui a permis aux jeunes éleveuses de mieux comprendre les enjeux de la microentreprise et d’appréhender leur métier d’éleveuse comme une réelle activité économique. Au-delà des compétences techniques, ces formations ont permis aux femmes de gagner en confiance et de réaliser tout ce qu’elles sont capables de faire. Les ateliers dédiés à la gouvernance et au leadership ont clôturé l’évènement en beauté avec ces 2 thématiques centrales de la vie associative. Les femmes témoignent, jour après jour, de tout ce que cela leur a apporté au quotidien en tant que femme et en tant que cheffe d’entreprise. 3 jeunes femmes se distinguent déjà : deux d’entre elle ont déjà le charisme et les qualités pour devenir femme leader (relais entre ROSA et les associations des femmes) et la troisième qui pourrait être formée aux soins Le marrainage, sur les pistes du partage et de la transmission intergénérationnelle ROSA et ESF expérimente dans le cadre du projet Imik S’Imik la mise en place de marrainage. Les marraines ont été choisies pour leur reconnaissance sociale, leur capacité et leur envie à transmettre. Et bien sûr pour leurs compétences et la qualité du suivi de leur élevage. Ces anciennes bénéficiaires des projets d’ESF ont exprimé leur fierté à transmettre ce que les précédents projets de ROSA et ESF leur ont apporté. Et que maintenant, c’étaient à elles de participer à la formation des femmes de leur village. Les marraines accompagnent 3 filleules. Ces groupes ont été suscités sur la base d’une proximité géographique et d’un choix mutuel entre marraine et filleul, dans lequel ROSA n’est pas intervenu. Pour que ce marrainage fonctionne, il est important que les personnes s’apprécient et se fassent mutuellement confiance. Dès le début, les marraines et filleules ont pris l’habitude d’échanger quasi quotidiennement sur les élevages, les difficultés que les débutantes rencontrent, les conseils techniques, etc. Les marraines deviennent ainsi relais précieux de l’association ROSA sur le terrain. Le marrainage est une très belle innovation qui tisse des liens entre générations, car souvent, la marraine est une femme plus âgée. Le souhait de ROSA et d’ESF est que les filleules, une fois lancées, aient à cœur d’être elles aussi marraines un jour. Ce projet a permis à 8 groupes (une marraine et 3 filleules) de se constituer Pour en savoir davantage sur le projet Imik S’imik Cliquez ici
Elevages sans frontières nominé pour le Prix Jean Cassaigne
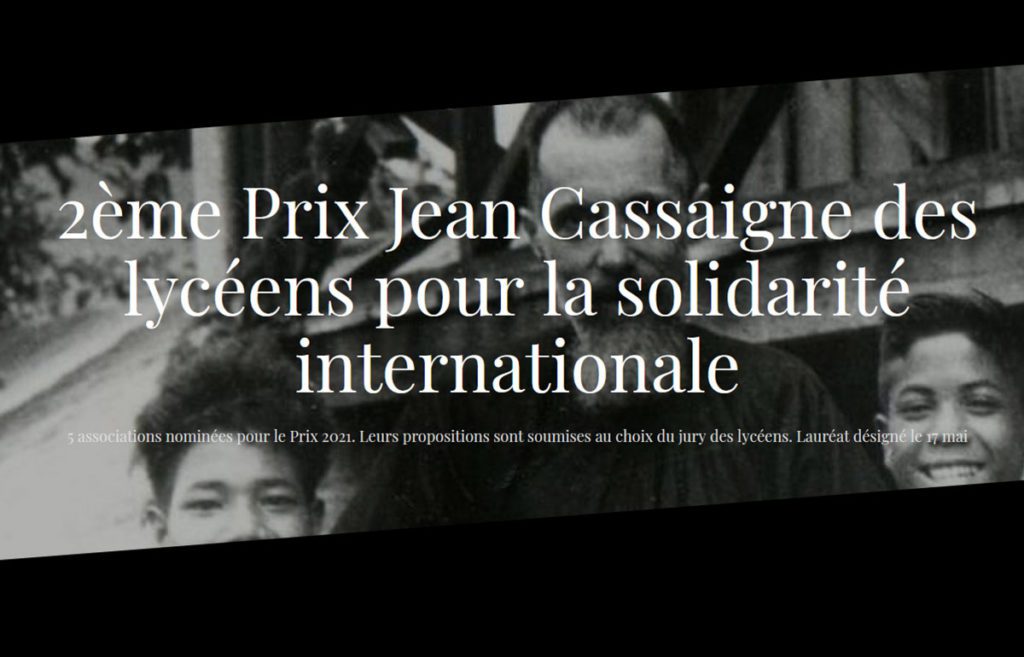
Cinq associations nominées pour le Prix Jean Cassaigne 2021 Après la Maison des Himalayas en 2020, qui sera le lauréat du Prix en 2021 ? Pour la deuxième fois en France, des lycéens vont récompenser d’un prix de 10 000 € une organisation française de solidarité internationale pour son action en faveur de populations vulnérables au Sud. Le groupe scolaire Jean Cassaigne et l’association les amis de Mgr Cassaigne souhaitent œuvrer ensemble en faveur de la solidarité internationale et de l’éducation à la solidarité internationale. En mobilisant la communauté française de la solidarité internationale et en sensibilisant un groupe de lycéens aux démarches, aux attendus et aux changements obtenus par des actions de solidarité internationale, ils font vivre le message de Jean Cassaigne qui s’est engagé au 20ème siècle auprès des populations les plus démunies du Vietnam. Après le 1er appel à propositions lancé en 2019/2020 qui a vu la Maison des Himalayas être récompensée pour son engagement en faveur des enfants souffrant de handicap en Inde, un 2ème appel à propositions a été ouvert entre janvier et mars 2021. L’objectif est de faire récompenser par ces lycéens une organisation française pour une action de solidarité internationale ayant amélioré de façon significative les conditions de vie de populations vulnérables dans un pays du Sud. C’est une initiative unique en France. 12 lycéens du groupe scolaire Jean Cassaigne se sont portés volontaires fin 2020 pour participer au jury. Ils ont retenu 5 thématiques prioritaires : Amélioration de l’éducation des enfants, notamment des filles, pour répondre aux objectifs d’égalité entre les sexes, tout particulièrement, mais pas seulement, dans les domaines des technologies de l’information et de la communication. Lutte pour la justice sociale, notamment au bénéfice des populations spoliées de leurs droits et de leurs biens, lutte contre les violences faites aux femmes Amélioration de l’accès aux soins des populations les plus vulnérables Amélioration de l’indépendance économique des femmes, notamment par un meilleur accès aux technologies de l’information et de la communication Adaptation au changement climatique, notamment pour les populations les plus vulnérables aux dérèglements climatiques. L’appel à propositions a connu cette année encore un grand engouement. 43 organisations ont répondu. Un comité d’experts indépendants a évalué les actions proposées par ces organisations. En se fondant sur le résultat de ces évaluations, 5 d’entre elles ont été présélectionnées. Il s’agit de : Enfants d’Asie pour son action en faveur des enfants défavorisés de Phnom Penh au Cambodge Les Enfants de Louxor pour son action en faveur des villageois de la rive Ouest de Louxor en Egypte Elevages sans frontières pour son action en faveurs des communautés paysannes vulnérables du Nord Togo MIVAOTRA pour son action en faveur des enfants des rues de Tananarive à Madagascar Le Samu Social International pour son action en faveur des enfants et des jeunes vivant en rue à Bamako, au Mali. Ces actions, détaillées sur le site internet du Prix Jean Cassaigne, sont en cours d’étude par les lycéens qui se réunissent le 17 mai pour sélectionner le lauréat 2021. Le Prix sera décerné à Mont-de-Marsan le 18 juin 2021. En savoir plus Un énorme merci aux lycéens. On croise les doigts maintenant !
Lancement du projet « Professionnalisation des ParaProfessionnels Vétérinaires (P3V) »

Lancement officiel et réunion de coordination nationale du projet : Elevages sans frontières y était. Ce mardi 4 mai 2021, Elevages sans frontières a confirmé sa participation à la coordination du projet P3V* au Togo porté par l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) et les professionnels de la santé animale du Togo (délégation d’Elevage, docteurs vétérinaires, centres de formation). D’autres ONG comme VSF-Suisse et AVSF étaient aussi conviées à la rencontre. Le projet est mené dans deux pays pilotes à savoir le Sénégal et le Togo, deux pays où intervient ESF. Il vise l’amélioration de l’offre de soins aux animaux afin de répondre aussi bien aux besoins des éleveurs qu’au besoin de contrôle des maladies. Une priorité au regard du contexte sanitaire actuel. Pour rendre plus efficace le réseau de professionnels de santé animale, le projet prévoit : – la mise en place d’une stratégie nationale, d’un cadre juridique et d’un système de contrôle efficaces pour un bon développement et une bonne articulation des professions de la santé animale,– l’amélioration de la formation et de l’intégration professionnelle des paraprofessionnels vétérinaires,– le développement de modèles économiques pérennes et la reconnaissance sociétale pour ces professions de la santé animale. ESF prévoit de contribuer à l’amélioration des curricula de formation et à l’insertion des paraprofessionnels, afin que les éleveurs de chèvres et de pintades accompagnés dans ses projets au Sud et au Nord du Togo puissent bénéficier de ce renforcement des capacités en Santé Animale. La devise de l’OIE, « Protéger les animaux, préserver notre avenir », s’inscrit dans la philosophie des projets d’Elevages sans frontières Sylvain Gomez, Responsable de projets et Coordinateur régional d’Afrique de l’Ouest * Projet mené avec le soutien de l’Agence Française de Développement (AFD)
Un an après le début de la crise sanitaire, où en sommes-nous ?

La situation en Afrique de l’Ouest Bonjour. Je suis Sylvain Gomez, Chargé de projet et coordinateur des actions en Afrique de l’Ouest. Je suis basé à Ouagadougou, au Burkina Faso, que je n’ai pas quitté depuis le début de la crise en mars 2020, excepté pour 2 missions au Togo en décembre 2020 et en mars 2021. Comment est gérée la crise aujourd’hui dans les pays d’intervention ? Dans le cadre de notre travail et dans la vie de tous les jours, nous veillons à poursuivre l’application des gestes barrières comme la limitation de contacts pour les salutations, le port du masque dans les endroits clos et le lavage régulier des mains. Ici au Burkina Faso, les personnes cas contacts et les personnes avec symptômes sont testées gratuitement. Les contrôles sont plus stricts au Togo : le test Covid est obligatoire à l’entrée dans le pays, des patrouilles anti-covid vérifient le port du masque dans les transports et les lieux publics, la musique est interdite dans les maquis pour limiter les rassemblements, une application de traçage par téléphone a été mise en place. Il y a également des mises en quarantaine régionale en cas de flambée du nombre de cas (comme pour la région des Savanes au Nord Togo en février dernier). Il y a de la sensibilisation mais aussi de la répression avec des amendes. Les mesures de prévention semblent davantage intégrées et appliquées par les populations dans les pays côtiers où nous intervenons (Togo, Bénin) qu’au Burkina Faso. L’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) réunie récemment a décidé d’uniformiser les modalités et la validité des tests Covid. La réouverture des frontières terrestres fin mai a aussi été évoquée. Sur le terrain, lors des réunions avec les éleveurs bénéficiaires de nos projets, nous avons l’avantage d’être sous un arbre, un hangar, en milieu chaud, sec, ouvert et aéré, où nous pouvons nous asseoir à plus de 1,5 m les uns des autres. Quelles sont les conséquences de la pandémie et les adaptations faites par ESF ? • A court terme La crise sanitaire a eu un fort impact social et économique. Les flux humains et de marchandises ont été freinés même si les frontières sont poreuses. L’argent rentre moins dans les ménages. Pour le secteur du tourisme, la crise sanitaire est venue s’ajouter à la crise sécuritaire liée au terrorisme. Pour les éleveurs accompagnés, l’approvisionnement en intrants (alimentaires ou sanitaires) s’est débloqué dans l’ensemble. Ils sont davantage concentrés sur la période de sécheresse (soudure) maintenant. Il faut cependant noter une augmentation globale des prix. La préparation des campagnes agricoles ou l’achat d’aliments pour les animaux pourraient s’avérer difficiles. Nous continuons à travailler sur la mise en place de circuits d’approvisionnement en aliments et en intrants pour les cultures (fertilisants et pesticides biologiques). La promotion de pratiques agroécologiques, comme la production de compost à partir des déjections animales ou la production de traitements biologiques pour les cultures, permet de répondre aux besoins des paysans. Les projets mis en place soutiennent aussi l’élaboration d’aliments à base des ressources locales. Notre challenge maintenant : intensifier la production de ces aliments confiés à des acteurs privés ou des organisations paysannes. Le travail mené avec les vétérinaires et les auxiliaires d’élevage villageois nous a permis de maintenir la santé des cheptels. Ces auxiliaires d’élevage tout comme les responsables des organisations paysannes ou des éleveurs référents ont aidé à maintenir le contact avec les bénéficiaires lors des périodes où la circulation sur les zones d’intervention devenait difficile. • A moyen terme Ce travail sur l’alimentation animale, les intrants agricoles et l’appui aux vétérinaires de proximité devraient aider à faire face à l’apparition de crises futures. La gestion environnementale est aussi de plus en plus au cœur de nos projets. Nous souhaitons diffuser les bonnes pratiques développées dans le cadre d’activités pilotes (comme les champs-écoles) pour un changement d’échelle des modes de production. Nous souhaitons aussi renforcer notre approche « Santé Globale » qui considère la gestion des ressources à l’échelle de l’écosystème. Une bonne gestion de l’ensemble des ressources productives (terre, eau, flore, faune, animaux d’élevage…) limite le passage de virus des animaux sauvages aux animaux d’élevage et à l’Homme. Sur le plan de la commercialisation des produits issus des élevages (viande ou lait), ESF continue son appui à la structuration de circuits courts de commercialisation pour une consommation de proximité et donc un maintien du chiffre d’affaires des éleveurs malgré la crise sanitaire. Sylvain Gomez, Responsable de projets et Coordinateur régional d’Afrique de l’Ouest La situation au Maroc Bonjour. Je suis Hassania KANOUBI, présidente de l’Association Rosa pour le développement de la femme rurale au Maroc. A ce jour, quelles sont les principales conséquences de la pandémie sur le plan économique et social pour la population ? Rosa travaille depuis 2010 sur l’élevage de chèvres et la fabrication du fromage. Elle aide plus de 200 éleveuses par ses activités de suivi des formations techniques et d’accompagnement de proximité des éleveuses en milieu rural. Ces activités ont été fortement impactées par les mesures restrictives prises pour freiner la propagation du virus, empêchant les déplacements de l’équipe, les ventes des fromages, etc. Cette crise sanitaire a également très rapidement touché l’économie des membres de la coopérative Corosa : la fermeture de la fromagerie pendant 1 an a entrainé une perte des stocks de fromages ainsi que la source de leur revenus mensuels. Corosa a en effet subi la crise du secteur touristique : le Maroc a rapidement fermé ses frontières, stoppant le tourisme extérieur. Le couvre-feu national a également arrêté le tourisme national. Or la fromagerie vend une grande partie de ses produits aux structures touristiques de la région de Ouarzazate, que ce soit des hôtels, chambre d’hôte ou restaurant. En outre, la majorité des femmes travaillent dans l’économie informelle. Cela signifie que leur revenu est précaire et qu’elles ne peuvent bénéficier des dispositifs mis en place par l’Etat. Les femmes éleveuses se sont trouvées isolées dans leurs foyers pendant le confinement. Aucun déplacement
